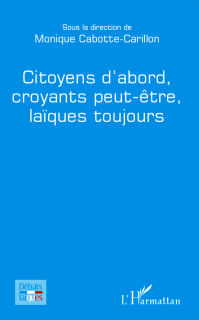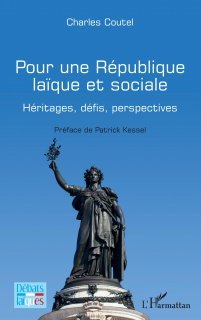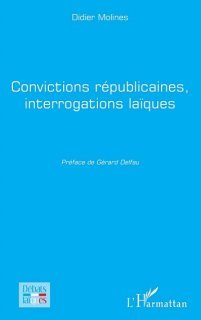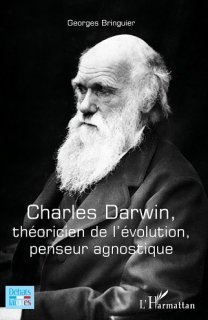Véronique FOURNIER- Puisqu’il faut bien mourir – La Découverte, 2015
Sur le modèle de ce qui se fait en Amérique du Nord depuis la fin des années 70, Véronique Fournier a créé en 2002, à Cochin, un Centre d’éthique clinique, le premier en France.
Son livre décrit et tire des enseignements, de 2004 à aujourd’hui, de dix cas de patients en fin de vie.
 Elle a notamment mis au point, progressivement, une méthode d’approche et d’écoute reposant sur quelques fondamentaux :
Elle a notamment mis au point, progressivement, une méthode d’approche et d’écoute reposant sur quelques fondamentaux :
- ne pas avoir de position a priori sur la question posée. Recevoir toute demande de façon accueillante.
- que le travail soit collégial et multidisciplinaire : son équipe est composée moitié de soignants, moitié de non-soignants : philosophes, sociologues, juristes, membres d’associations de patients, psychologues, psychanalystes. Outre la variété et la richesse des points de vue, cette approche permet aussi de rendre la société civile témoin de la difficulté des demandes faites à la médecine.
- pas de jugement en bien ou en mal. C’est la méthode qui est éthique.
D’où le message du livre : « porter une demande de mort, pour soi ou pour autrui, ne devrait plus être reçu a priori comme indigne ni insensé. Ce sont des demandes exceptionnelles, sans risque aucun de dérive » (19).
Carl, deux ans et demi, en état neurovégétatif l’état est dit « neurovégétatif » [1] depuis plusieurs mois après s’être noyé dans quelques dizaines de centimètres d’eau. On est en 2004, avant la loi Léonetti ; pour les équipes soignantes, l’interdit de tuer est absolu, où V. Fournier distingue au moins deux dimensions : une défense structurante des équipes de soins, indispensable à leur survie (27), et la responsabilité institutionnelle du chef de service, comptable du bon fonctionnement de son équipe (29), deux aspects qui, sur ce cas précis, heurtent de plein fouet la volonté des parents de laisser partir leur enfant. Dans ce genre de tensions dramatiques, la maturation de la décision s’étire sur des mois. La loi Léonetti ayant été votée (à l’unanimité) dans l’intervalle, « peut-on admettre que la qualification éthique d’un acte change d’un jour à l’autre, du simple fait d’une loi, alors qu’il s’agissait pour les parents de libérer leur fils ? » (32).
Finalement, Carl mourra d’une aggravation de son état que le médecin-chef a décidé de ne pas traiter. Plusieurs années après, la mère de Carl a écrit un livre, Laissez-le partir, tandis que Véronique Fournier revisitait le principe cardinal de la médecine : primum non nocere, concluant sur ce premier cas auquel son équipe fut confrontée : « j’ai compris qu’il nous fallait, nous médecins, admettre que lorsque nous ressentons comme malfaisant l’acte de tuer, c’est davantage nous-mêmes que nous protégeons que le malade » (35). Le refus est respectable, il est d’ailleurs reconnu au titre de la clause de conscience, mais il ne peut pas être avancé au nom du primum non nocere.
Un mois après la mort de Carl, la mère de Berivan contacte le Centre d’éthique. Ils sont kurdes, arrivés en France en 1982, leur fille avait trois ans. Jusqu’à dix ans, elle a vécu la vie d’une enfant comme les autres, heureuse, épanouie, puis elle devient victime de comportements étranges, qui s’aggravent. Diagnostic : maladie neurovégétative dégénérative, avec destruction progressive du cerveau.
Cela fait quatorze ans qu’elle est inconsciente et que ses parents se relaient à son chevet. Ils en sont arrivés au point où ils demandent qu’on libère Berivan. A ce moment-là, la loi Léonetti est passée : dorénavant, l’alimentation artificielle peut être considérée comme un traitement ; comme, par ailleurs, la loi dit aussi qu’on peut, en cas d’acharnement thérapeutique, arrêter tout traitement, cela vaut aussi pour cette alimentation. Mais le Centre est alors confronté à deux difficultés : d’une part, s’il est légal, l’arrêt d’alimentation reste mal accepté par les équipes de soins palliatifs ; d’autre part, on ne sait rien alors de ce qu’il se passe si on arrête d’alimenter une jeune femme, en pleine santé à part son encéphalite, et dont le cœur pouvait résister longtemps : combien de jours ? Quelles doses de sédatifs prescrire ? En France, personne n’avait d’expérience.
Se poursuit alors, pendant deux ans, le calvaire des parents de Berivan qui passent d’une équipe de soignants à l’autre, les premiers acceptant le geste définitif, remis en cause par les seconds. Ce sont là les limites (l’hypocrisie ?) de la loi de 2005, qui a autorisé l’arrêt d’alimentation et d’hydratation, mais interdit l’injection létale : un compromis, à nouveau, pas une vérité éthique.
Enfin, la décision est prise mais l’agonie de Berivan sera vue de manière très différente par sa mère et le médecin, la première, bouleversée, confiant à V. Fournier que l’arrêt de l’alimentation s’était traduit pour sa fille par une agonie très longue et très douloureuse ; le second, formel, estimant que Berivan n’avait pas souffert et que les symptômes observés étalent ceux, habituels, de toute agonie, laquelle « est rarement totalement paisible et agréable à regarder » (59).
De cette douloureuse épreuve, Véronique Fournier a tiré plusieurs conclusions : d’abord qu’« il y a actuellement un profond hiatus entre ce que beaucoup de nos concitoyens attendent de la médecine comme accompagnement à la mort, et ce que la médecine se sent capable d’apporter comme aide aux mourants. Petit à petit, la médecine a appris à se retirer… Mais, dans son ensemble, elle n’est pas prête à aider à l’évitement de l’agonie » (60). Ensuite, qu’il ne faut pas méconnaitre non plus les conséquences de ces choix collectifs pour ceux qui ont à les supporter. De ce point de vue, les soins palliatifs voient juste quand ils notent que la vraie difficulté n’est pas ceux qu’on accompagne vers la mort, mais ceux qui restent, les vivants, avec les souvenirs qu’ils garderont de l’agonie de leurs proches (61).
Alexandre, Achim, Andreï, Amina et Vincent Lambert aussi
Ce chapitre tente de cerner « ces états étranges appelés neurovégétatifs », au nombre de 1 500 à 1 700, en France. Deux termes les désignent, neurovégétatif et pauci-relationnel mais, en fait, affirme V. Fournier, personne ne sait très bien répondre à la question de ce que sont, très précisément, ces états. En principe, avec les patients dits en état neurovégétatif, aucune communication fiable n’est possible, tandis qu’avec ceux dits en état pauci-relationnel, il est possible de communiquer à minima.
Mais le distinguo est très théorique, car : 1- tous les cas de figure existent entre ces deux catégories. 2- dans l’une comme dans l’autre, on a établi des échelles de classement selon différents degrés de sévérité. 3- un même patient est souvent fluctuant d’un jour à l’autre. L’incertitude est d’autant plus handicapante que c’est la distinction entre les deux états qui fonde le pouvoir d’objectiver l’obstination déraisonnable, alors que la frontière entre eux est « poreuse, instable et incertaine » (79).
Conclusion de V. Fournier : « la différence (entre ces deux états) ne présente cliniquement aucun intérêt, voire elle est dangereuse. » Comment trancher alors ? En tenant compte de ce qu’ont expérimenté au chevet du patient ceux qui s’en sont occupés quotidiennement (81). Et nul débordement, V. Fournier en est convaincue, n’est à craindre : les demandes d’aide à mourir sont exceptionnelles ; elles concernent actuellement en France un ou deux patients par an.
Pour Germaine, atteinte de la maladie d’Alzheimer, c’est sa fille qui demande qu’on enlève la sonde qui nourrit sa mère. Refus des médecins. Intervention du Centre d’éthique, au mécontentement de l’équipe soignante qui, finalement, se rend sur l’argument patrimonial (sauver une ferme). De cette expérience, V. Fournier a tiré deux enseignements … :
- toujours rechercher la personne qui apparaît la plus « légitime » pour porter le meilleur intérêt du patient concerné (96).
- « il est frappant de voir combien l’inquiétude morale résiduelle est souvent inversement proportionnelle à la proximité vis-à-vis de ces histoires. Les plus proches sont les moins inquiets. Alors que lorsqu’on reste loin de la réalité concrète des choses de tous les jours … lorsqu’on ne raisonne qu’à partir de références morales et de principes éthiques éthérés, c’est là que le doute gagne » (98).
… et une question lancinante : est-ce vraiment une solution de laisser des personnes s’éteindre à petit feu ? Est-on si certains qu’elles n’en souffrent pas ?
Jeanne est née avec une micro-encéphalite lisse, c’est-à-dire avec un petit cerveau aux capacités limitées, et d’emblée c’est la médecine seule qui la fait vivre. Après quelques mois, ses parents demandent instamment qu’on arrête les soins : « la vie la plus digne pour ma petite fille sera la vie la plus courte. »
Dans un cas comme celui-ci, la réflexion du médecin s’articule autour de quatre points-clés : savoir si la médecine a participé à ce que l’enfant survive ; vérifier si l’enfant dépend ou non d’un traitement vital ; état neurologique attendu ; qualité de la relation qui parvient à se nouer ou non entre l’enfant et la famille. Les pédiatres sont d’autant plus accessibles à la demande des parents, quand elle persiste, qu’ils sentent l’ensemble de la famille en danger. A partir de là, le temps de la décision ne peut être que long, mais une grande partie de ce temps est incontournable, car il est indispensable à la lente maturation des choses. C’est ce qu’il s’est passé pour Jeanne, dont le médecin, après mure réflexion, a décidé de retirer la sonde qui l’alimentait et de l’accompagner à mourir sans souffrir. Mais, contrairement à celui de Germaine qui n’exprimait plus rien, Véronique Fournier ne peut oublier le regard de l’enfant « si bleu, doux, attentif, innocent. »
Avec Bernard et Michel, Véronique Fournier a franchi un seuil, celui de l’aide au suicide. Bernard souffrait d’une sclérose en plaques, « cette maladie neurologique dégénérative épouvantable, par laquelle on perd, petit à petit, toutes ses capacités musculaires jusqu’à devenir emmuré dans un corps devenu totalement inefficace, tout en gardant parfaitement intactes ses facultés intellectuelles. » Bientôt il ne pourrait plus se nourrir seul, on serait obligé de lui poser une sonde dans l’estomac, puis les muscles de la respiration se paralyseraient, il lui faudrait l’aide d’un respirateur artificiel. Pour Bernard, la limite était la pose de la sonde d’alimentation.
A ce stade, son médecin avait l’impression d’une instrumentalisation d’elle-même et de la loi : si Bernard refusait de s’alimenter, c’était sa liberté, mais elle ne voyait pas pourquoi ce serait à elle de l’accompagner avec des soins palliatifs, qui sont faits pour accompagner jusqu’à la mort des patients en fin de vie, pas pour les endormir et faire en sorte qu’ils puissent éviter par là de se confronter à la mort. Pour V. Fournier au contraire, décider du moment de sa fin, c’était sa façon à lui, Bernard, de reprendre un tant soit peu la main face à son destin.
C’est en définitive ce qu’il s’est passé : Bernard s’est nourri et a bu de moins en moins, tandis qu’on lui posait une perfusion pour le calmer et l’endormir. Le processus suivait son cours quand soudain, au sixième jour, il a repris ses esprits à l’horreur et à la douleur de son fils. Puis il est mort quelques jours plus tard, mais le mal était fait. L’erreur était médicale : le médecin avait bien administré les doses habituelles, mais sans se rendre compte qu’elles étaient adaptées aux soins palliatifs, à des personnes au bout de leur existence.
Michel, victime d’un locked-in syndrom après un AVC massif, était depuis plus de deux ans dans un état stable. La médecine l’avait sauvé, en espérant qu’il pourrait s’adapter à son nouvel état de tétraplégique (plus aucune activation de ses muscles tout en conservant toute sa tête). Ce ne fut pas le cas et pour lui aussi le suicide apparaissait comme la seule issue possible. Ce sont sa femme, ses filles, sa belle-sœur qui, pendant trois ans, se sont battues, ont donné à sa demande un écho public, travail ingrat, parfois entouré de suspicion, admirable aussi, grâce auquel, enfin, Michel a obtenu ce qu’il voulait.
De ces deux cas, Véronique Fournier a tiré plusieurs constats et conclusions :
- « culturellement, les médecins ont souvent du mal à faire suffisamment cas du consentement ou du non-consentement du patient, estimant qu’ils savent mieux que lui ce qui est bon pour lui. » « Ils n’aiment pas trop que les patients leur tiennent tête, alors que pour Bernard comme pour Michel, ce n’était pas aux médecins qu’ils tenaient tête, mais au destin et à la maladie » (135).
- elle a changé d’avis sur le suicide assisté, mais estime qu’« il faudrait absolument que les médecins soient parties prenantes du dispositif, pour plusieurs raisons : d’abord, il n’est pas si facile de ne pas rater son coup (cf. le rapport Sicard : si le gouvernement autorisait l’aide au suicide, il faudrait confier la procédure à l’institution soignante, pas à des associations comme en Suisse) ; ensuite, c’est ce que souhaitent les gens. En France, nous restons confiants dans la société pour organiser au mieux le bonheur de tous. … Nos concitoyens attendent des médecins qu’ils mettent leur art au service de la population, y compris pour mourir bien ».
Et elle conclut, comme précédemment, sur sa conviction que la demande ne risque aucunement de devenir massive. Pour souhaiter la mort, il faut vraiment être acculé (135, 136).
Exception aux cas rapportés par V. Fournier, celui du vieil homme cardiaque n’est pas douloureux. Il s’agit d’un homme, âgé, malade du cœur, qui va en mourir, le sait et l’accepte sans drame. Ce qui a intrigué Fournier, c’est ce mélange étrange d’acceptation de la mort et de refus d’en tirer les conséquences pratiques, notamment en matière de directives anticipées. Elle oublie, là, que jusqu’à la loi récente Claeys-Léonetti, ces directives n’étaient pas contraignantes, mais elle apporte aussi à l’appui de son commentaire des observations qui ne remettent pas en cause la justesse des directives, mais qui n’en font pas non plus la sorte de panacée qu’y voit l’ADMD : une enquête de son Centre a montré que, pour les vieux, « la survie passait par le fait de laisser le futur grand ouvert » (150), le point décisif étant le refus de « lier l’avenir » (155) ; et ce constat peut être élargi aux pays où elles existent depuis longtemps (Etats-Unis, Australie), et où elles ne sont utilisées que dans 10 % à 20 % des cas (158).
Elle voit à ces contradictions des raisons philosophiques : 1- « conçues comme un instrument au service de la liberté, elles sont vécues comme amoindrissant cette liberté ». 2- « la démarche consiste à prévoir le futur. Or, prévoir le futur vide celui-ci de son intérêt même. Le futur pour être futur doit rester porteur d’inconnu et d’espérance » (158). Autrement dit, les directives anticipées sont certainement un outil qu’il faut faire connaître mais elles ne sont pas l’alpha et l’oméga de la réponse des vivants à la crainte de la mort.
Ninon et Tonino, les affamés
Aux deux extrémités de la vie, on touche concrètement et très douloureusement aux limites de la loi Léonetti. Il existe des enfants pour lesquels l’issue la moins douloureuse serait la mort, mais chez qui l’arrêt des traitements de réanimation ne suffit pas à la faire advenir. Comment croire dans de tels cas, que priver son enfant de nourriture jusqu’à ce qu’il en meure puisse être vécu par des parents comme une mort naturelle ? Eux ne soufrent pas l’incertitude : si la situation de leur enfant est grave au point que les soignants abandonnent la partie, ils l’acceptent mais ils demandent alors qu’on l’aide à partir. Les médecins leur assurent qu’un arrêt d’alimentation, qui est permis par la loi, n’entraîne aucune souffrance, mais ils ne peuvent admettre que, la décision étant prise, on ne prenne pas les dispositions qui permettraient d’en finir sans attendre. « Des entretiens menés avec eux, il ressort avant tout que l’arrêt d’alimentation et d’hydratation n’a fait qu’aggraver leur sentiment de ne pas avoir réussi à protéger leur enfant contre l’adversité » (172).
La même difficulté, la même angoisse se retrouvent à l’autre bout de la vie. On connaît en gériatrie la très grande place des troubles de l’alimentation ; ceux de la déglutition en particulier font partie des symptômes de la dégénérescence liée au vieillissement. Ainsi, pour les grands vieillards, l’alimentation est tout sauf naturelle, elle a été transformée et technologisée. On peut vivre longtemps ainsi, mais quel sens cela a-t-il ? Les médecins sont alors confrontés à une « alternative diabolique » : mourir par étouffement ou laisser mourir de faim, personne n’osant prendre la décision de tout interrompre et d’accompagner à mourir.
V. Fournier n’a ni solutions, ni propositions : « je sais seulement que la question est énorme. Et qu’elle est aujourd’hui totalement occultée » (183).
Curieux chapitre que celui consacré à Laurent, « neurovégétatif ou pauci-relationnel », que V. Fournier, intitule Naissance d’un rituel. Après avoir tout au long des chapitres précédents montré et parfois critiqué la philosophie des soins palliatifs et les comportements qui en dérivent, elle en dresse ici le panégyrique : « l’accompagnement palliatif est un remarquable outil de ritualisation et de socialisation de la mort … presque plus intéressant par sa dimension sociale que par sa dimension strictement médicale. … La mort du patient devient un temps offert à la famille et aux proches. Un temps d’apprivoisement de la mort. » (197).
On peut même dire qu’elle revient sur ses prises de positions antérieures lorsqu’elle décrit les trois ingrédients d’un accompagnement à mourir « réussi » : d’abord, la non-violence des actes médicaux, c’est-à-dire le refus d’une injection létale, qui présente à ses yeux trois inconvénients : passage à l’acte ; actes trop brefs ; et relevant toujours du contrôle et du pouvoir de la technique et de la médecine. Ensuite, veiller à ce que le temps que dure l’attente de cette mort annoncée ne soit ni trop bref, ni trop long, ni trop maîtrisé. Beaucoup dépend enfin du contenu apporté aux quelques jours qui restent, là où se manifeste la quintessence du savoir-faire des soins palliatifs, dont les accompagnements prennent peu à peu la place d’un nouveau rituel de mort.
C’est ainsi qu’elle arrive à la conclusion que, au bout du compte, « peu importe que la demande soit euthanasique ou non. Le plus important réside dans la qualité de l’accompagnement … qu’on en vient, de fil en aiguille, à considérer comme une posture éthique en soi » (204).
L’homme du triathlon
Quarante-cinq ans, hyperactif, il venait de disputer le triathlon de New York quand ses jambes ont commencé à se dérober sous lui, à l’improviste : maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, qui empêche les muscles de fonctionner les uns après les autres. Irréversible, le malade, lucide, n’avait qu’une exigence : décider de sa fin par lui-même, avoir « une mort qui n’appartienne pas à la médecine ».
Le moment venu, l’équipe du Centre a constaté que, depuis quelques années, la plupart des médicaments autrefois disponibles en pharmacies de ville, susceptibles de plonger les patients dans un sommeil profond, avaient été progressivement retirés du marché, et que les médecins de ville étaient devenus les otages des pharmacies hospitalières via les réseaux de soins palliatifs (210). « Un médecin eut le courage de braver les soins palliatifs, et aussi celui de se procurer subrepticement des drogues interdites à la vente en ville » (213).
Epilogue
De ces expériences souvent douloureuses, parfois traumatisantes, Véronique Fournier, dont le point de vue a évolué en dix ans, a tiré plusieurs enseignements, la pensée, précise-t-elle, s’étant construite à plusieurs (223) :
- euthanasie : le mot est rejeté avec violence, comme s’il renvoyait à un état de barbarie, et pourtant il ne faut pas hésiter à l’utiliser, « ne pas se laisser enfermer dans des concepts et des principes, des définitions du bien et du mal, immuables, universelles et normatives. Il faut admettre que la société bouge et avec elle parfois certains de nos référents fondamentaux » (30).
- les progrès de la médecine sont tels qu’elle est capable aujourd’hui de maintenir artificiellement n’importe quelle vie, pendant un temps indéfini (28). La contrepartie de ces progrès magnifiques est que la mort ne vient plus toute seule. Dans bien des cas, il faut décider qu’elle survienne (226). Par exemple, la plupart des morts par défaillance cardiaque semblent désormais pouvoir être évitées et l’on se demande même parfois si l’on n’empêche pas les gens de mourir du fait de nos techniques. Et il n’est pas sûr que ce soit un bien, les perspectives à un âge avancé étant de mourir de cancer ou de dégénérescence neurocérébrale (141).
- la question à se poser : qu’est-ce qui honorerait le plus le patient en fin de vie ? (217). Et une partie de réponse : « tout faire pour aider à supporter l’épreuve et la rendre plus légère » (28).
- admettre la double impasse de la loi Léonetti : 1- l’arrêt d’alimentation et d’hydratation artificielles est irrecevable socialement ; logique techniquement, il est incompréhensible culturellement (229). 2- le principe de non-intention (« laisser mourir, oui, faire mourir, non »), louable in abstracto, n’est pas opératoire dans bon nombre de cas. Il faut donc abandonner cette distinction, et assumer ouvertement le fait que l’intervention médicale est vraiment que le patient meure. On ne peut pas continuer à die que l’on arrête les traitements et qu’on n’est pour rien dans la mort qui va arriver (230).
- cela assumé, il faut ensuite libérer la main des médecins, sans interdit : oui, ils ont l’intention que ce patient meure et c’est pour qu’il meure « bien ». Mais il ne suffit pas d’autoriser les médecins à endormir leurs patients. On ne meurt pas de dormir, y compris de la sédation profonde et continue. Si on finit par mourir, c’est en réalité parce qu’on a arrêté l’alimentation et l’hydratation (231). N’est-il pas hypocrite de considérer que la suspension d’un traitement vital relève du « laisser mourir » plutôt que du « faire mourir » ? (226). Libérer la main des médecins veut donc dire les autoriser … à accompagner la décision de retrait des traitements par une aide active à mourir. Il faut construire ensemble la mort, faire que les choses soient le plus adaptées possibles à ceux qui sont concernés, aider à ce que la mort devienne tolérable, apprivoisée, civilisée (232).
« Peut-être est-ce cela que nous, les soignants, devons à nos concitoyens en matière d’aide à mourir : écouter ce qu’ils ont à dire, pour s’ajuster au plus près au moment de l’échéance, y compris en ayant le courage d’un ultime geste si nécessaire, au bout de la médecine et de l’accompagnement, y compris palliatif, sans opposition entre l’une et l’autre démarche » (219). Quant au risque de dérive, il est franchement peu à craindre, tant est considérable la puissance des forces de vie (227).
Pour terminer, deux positions de Fournier plus hasardeuses, voire pour l’une d’elles carrément contestable :
- Les soignants sont les premiers à savoir que le statut de l’autonomie n’est pas le même pour le patient et pour eux. Le premier joue sa peau, le second un petit bout de son âme, guère plus.
Là, je ne suis pas d’accord : d’abord le patient ne joue pas sa peau puisqu’elle est déjà sacrifiée ; ensuite, il est très léger de ramener au sacrifice juste d’« un petit bout d’âme » la responsabilité prise de tuer quelqu’un, fût-ce simplement en hâtant sa mort.
- constater que « les situations dans lesquelles la mort ne vient pas … sont la contrepartie des progrès considérables qu’a faits la médecine » (235) est un fait. Cela entraîne-t-il, ipso facto, que « l’euthanasie doive être envisagée comme la contrepartie de ces progrès ? ». Sans que je sache dire pourquoi, le lien de cause à effet ne me semble pas couler de source.
Alain AZOUVI
 Gérard Delfau, Directeur de la collection
Gérard Delfau, Directeur de la collection




 Le choix laïque d’une intranquille
Le choix laïque d’une intranquille
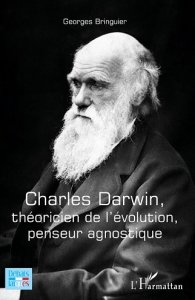 Charles Darwin - Théoricien de l’évolution, penseur agnostique. - Georges Bringuier -
Charles Darwin - Théoricien de l’évolution, penseur agnostique. - Georges Bringuier -
 Ils ont pensé l’École républicaine - Gérard Bouchet
Ils ont pensé l’École républicaine - Gérard Bouchet